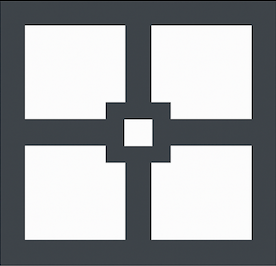L’article applique au cas Airbus une lecture fonctionnelle de la compliance transnationale, où se superposent RGPD, Sapin II, FCPA, Cloud Act/ITAR-EAR, AI Act, NIS2/CRA, CSRD/CSDDD et normes EASA/FAA/ISO.
Cette superposition génère indécidabilité, instabilité et saturation, accentuées par l’extraterritorialité, les transferts de données, l’export control et des chaînes probatoires hétérogènes.
Six effets structurants sont décrits : saturation procédurale, contournements défensifs, indécidabilité décisionnelle, fragmentation fonctionnelle, déplacement des responsabilités, conformité mimétique.
Des effets secondaires apparaissent : absence d’articulation entre cadres, éclatement de la preuve, friction innovation/régulation, effets inverses du reporting, asymétrie procédurale, externalisation de la décision.
Apport central : ancrer les arbitrages sur des « effets juridiquement évaluables » et leurs conditions de recevabilité pour rendre la conformité opérable et défendable, malgré l’absence d’une hiérarchie normative unifiée.
- La superposition de cadres hétérogènes et extraterritoriaux (RGPD, Sapin II, FCPA, Cloud Act/ITAR, AI Act, NIS2/CRA, CSRD/CSDDD) génère des effets systémiques récurrents : indécidabilité, saturation procédurale, fragmentation organisationnelle, éclatement de la preuve, déplacement des responsabilités.
- La lecture fonctionnelle recentre l’analyse sur les effets juridiquement évaluables et leurs conditions de recevabilité, rendant visibles les tensions structurelles entre prévention, transparence, secret, partage contraint, ainsi que les réponses observées (conformité mimétique, contournements défensifs).
- Apport opérationnel : un cadre de décision pour juristes, DPO et RSSI afin d’arbitrer sans harmonisation préalable, objectiver les conflits de normes, documenter des choix défendables et stabiliser des points d’ancrage de gouvernance, de preuve et de contrôle, rendant la compliance plus opérable et stratégique.
1. Introduction
Les grandes entreprises internationales doivent aujourd’hui naviguer entre des cadres juridiques multiples. Cet article s’intéresse aux effets juridiques produits par la superposition de dispositifs tels que le RGPD, la loi Sapin II, le FCPA ou l’AI Act, dans le contexte d’une compliance transnationale.
En prenant appui sur le cas documenté d’Airbus, il mobilise une lecture fonctionnelle pour modéliser les effets d’indécidabilité juridique, d’instabilité normative et de saturation structurelle.
Il examine :
- les effets juridiques engendrés par l’articulation instable de dispositifs tels que le FCPA, la loi Sapin II, le devoir de vigilance, l’export control, le RGPD, le Cloud Act, la CSRD ou l’AI Act ;
- les tensions entre conformité réglementaire, obligations extraterritoriales et lisibilité des responsabilités dans les architectures juridiques distribuées.
Le texte s’inscrit dans une démarche d’analyse fonctionnelle, sans visée normative ni prétention à l’exhaustivité. Il vise à rendre lisibles des dynamiques observables, fondées sur la reconnaissance des effets juridiquement évaluables produits par un système régulé.
2. Régimes juridiques applicables à Airbus : entre chevauchements normatifs et tensions systémiques
2.a Cadre de lecture
Cette cartographie ne repose pas sur une approche doctrinale ou prescriptive. Elle vise à rendre lisibles les effets juridiques concrets produits par la superposition de régimes normatifs applicables à un acteur global tel qu’Airbus, dans ses différentes fonctions (industrielle, commerciale, employeur, contractant public, opérateur de services numériques…).
L’analyse prend appui sur une logique systémique :
- Ce ne sont pas les intentions ou les sources formelles seules qui sont examinées, mais les effets juridiques et opérationnels que ces dispositifs produisent, en interaction, dans des environnements à haute complexité.
- La cartographie tient compte des régimes directs (obligations applicables à Airbus en tant que personne morale) mais aussi des effets induits (transmission, dépendance, conflit, contournement, dilution normative…).
L’objectif est de documenter les zones de chevauchement, d’ambiguïté ou d’indécidabilité juridique, qui caractérisent les configurations transnationales à forte densité normative.
2.b Usages possibles de la cartographie
Cette cartographie peut être mobilisée comme outil d’analyse croisée dans plusieurs contextes professionnels :
- Pour les juristes : repérage des conflits de normes, des lacunes de transposition, ou des zones d’interférence entre souverainetés juridiques (UE/USA, droit public/privé, etc.), par exemple chez un acteur comme Airbus, soumis à la fois au RGPD, aux régimes extraterritoriaux américains (Cloud Act, ITAR), aux obligations européennes de cybersécurité (NIS 2, CRA), et à des règles sectorielles aéronautiques complexes ;
- Pour les DPO : identification des périmètres différenciés d’application du RGPD selon les rôles exercés par l’entité (employeur, responsable de traitement, sous-traitant de données sensibles, etc.), avec un enjeu fort de coordination entre les sièges européens et les filiales internationales du groupe ;
- Pour les RSSI : lecture transversale des obligations en matière de cybersécurité, de traçabilité et de notification d’incidents, en tenant compte des exigences croisées de la défense, de l’aviation civile et du droit européen ;
- Pour les régulateurs : analyse des effets systémiques induits par l’empilement de régimes hétérogènes, dans le cas d’Airbus, cela peut inclure l’étude de la cohérence entre les mesures de souveraineté numérique et les engagements contractuels internationaux ;
- Pour les auditeurs : clarification des critères d’évaluabilité des dispositifs de compliance, en particulier dans les configurations où plusieurs régimes normatifs s’appliquent simultanément sans harmonisation préalable. Cette lecture permet de documenter la soutenabilité juridique et opérationnelle de la stratégie déployée, dans des environnements transnationaux.
L’ensemble permet de qualifier des effets réels (juridiques, économiques, techniques) sans dépendre d’un seul référentiel, et de cartographier des tensions invisibles pour des approches uniquement textuelles ou prescriptives.
3. Régimes juridiques applicables à Airbus SE (Cartographie non normative)
La structure suivante propose une lecture simplifiée des principaux régimes susceptibles d’encadrer les activités d’Airbus SE. Elle n’a pas vocation à l’exhaustivité ni à la prescription. Elle vise uniquement à fournir un repère analytique initial sur certaines zones de recouvrement entre contraintes juridiques, techniques et organisationnelles dans un contexte transnational.
3.a Paramètres d’environnement
- Statut juridique : Société européenne (SE) régie par le droit néerlandais, siège statutaire à Leiden, direction opérationnelle centralisée à Toulouse.
- Présence géographique : entités réparties dans l’Union européenne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine, en Inde, et dans plusieurs États tiers.
- Domaines d’activité : aviation commerciale, défense, spatial, cybersécurité, services connectés.
- Paramètres structurels de contexte :
- Activités à double usage (civil/militaire),
- Intégration dans des programmes de défense européens,
- Régulations différenciées selon zones géopolitiques.
3.b Régimes de conformité (aperçu)
Les éléments ci-dessous constituent une sélection partielle de régimes mobilisables ou susceptibles d’avoir une incidence, sans hiérarchisation ni affirmation d’applicabilité uniforme.
- Données personnelles :
- RGPD (traitements RH, dispositifs de vidéosurveillance, maintenance prédictive, plateformes numériques),
- Usage d’outils collaboratifs transfrontaliers,
- Risques liés aux transferts hors UE (BCR, sous-traitance).
- Normes sectorielles et techniques :
- Certification aéronautique : EASA, FAA, ICAO,
- Référentiels critiques : DO-178C, DO-254, ISO/IEC 27001,
- Export control : règlement (UE) 2021/821, ITAR/EAR (États-Unis), dispositifs nationaux.
- Cloud et infrastructures numériques :
- Partenariats avec prestataires extra-européens,
- Cadres mobilisables : doctrine de confiance ANSSI, référentiels CNIL, Data Governance Act.
- Conformité extraterritoriale :
- Anticorruption : FCPA, UK Bribery Act, Loi Sapin II, directive 2019/1937,
- Régimes de sanction : OFAC, CAATSA, listes de restriction, obligations de vigilance,
- Normes ISO : 37001 (anticorruption), 37301 (compliance).
- Responsabilités nouvelles :
- Réglementation IA (AI Act),
- Extension aux composants logiciels (règlement 2024/2853),
- Vigilance environnementale et sociale (directive CSDDD),
- Interférences possibles avec DSA, DMA, régulations sectorielles.
3.c Zones de tension réglementaire
- Possibles conflits d’articulation entre normes américaines, européennes et nationales,
- Frictions entre exigences de transparence (données, audits) et régimes de secret (défense, export),
- Répartition complexe des responsabilités au sein des chaînes techniques ou industrielles,
- Difficultés d’accès aux preuves dans des environnements classifiés ou contractuellement verrouillés,
- Contradictions entre obligations extraterritoriales et droits locaux.
Ce repère peut faciliter l’identification d’effets juridiques distribués, notamment dans des contextes où les contraintes ne relèvent d’aucun régime unique identifiable.
4. Effets produits par la structure régulée
L’analyse des dynamiques engendrées par l’architecture juridique encadrant Airbus met en évidence une série d’effets structurels issus de la combinaison entre :
- la superposition de normes (européennes, nationales, extraterritoriales),
- la distribution fonctionnelle des responsabilités (juridique, technique, contractuelle),
- et les exigences de preuve ou d’évaluation propres à chaque régime.
Six effets structurants peuvent être caractérisés :
4.a Saturation procédurale
La juxtaposition de dispositifs de contrôle (conformité export, traçabilité RGPD, obligations IA, audits éthiques…) entraîne une démultiplication des chaînes internes de validation, souvent parallèles et rarement synchronisées. Cette densification réduit la fluidité opérationnelle, accroît la dépendance documentaire et sollicite durablement des expertises sans garantie de portabilité probatoire inter-régime.
4.b Contournements défensifs
Confrontées à des injonctions antagonistes (par exemple RGPD vs Cloud Act, FCPA vs confidentialité contractuelle), certaines entités développent des tactiques d’atténuation du risque : opacité documentaire, choix juridictionnel opportuniste (forum shopping), ou implémentation minimale des obligations (compliance pragmatique). Si ces stratégies réduisent l’exposition immédiate, elles compromettent l’intégrité du dispositif dans son ensemble.
4.c Effets d’indécidabilité
L’absence d’articulation harmonisée entre cadres applicables engendre des zones de blocage décisionnel. Lorsqu’un projet se heurte à des prescriptions incompatibles (par exemple interdiction de transfert par le RGPD, exigence d’accès par une autorité tierce), les circuits internes s’enrayent. Le droit reste applicable en théorie, mais devient indécidable en pratique au regard des contraintes croisées.
4.d Fragmentation fonctionnelle
La répartition des obligations entre pôles spécialisés (RSSI, DPO, juridique, export, éthique…) induit un risque de disjonction organisationnelle, faute de coordination consolidée. Cette dispersion nuit à la lisibilité des priorités normatives, accentue les écarts d’interprétation, et affaiblit la cohérence globale du dispositif.
4.e Déplacement périphérique des responsabilités
Certaines charges réglementaires sont transférées, explicitement ou non, vers des sous-traitants, partenaires ou entités extraterritoriales. Ce transfert vise à alléger la pression sur la maison mère, sans garantie de soutenabilité juridique du relais. Il en résulte un affaissement du contrôle direct et une exposition latente accrue en cas de manquement.
4.f Conformité mimétique
L’impossibilité d’aligner tous les régimes simultanément, combinée à l’industrialisation des vérifications, favorise des formes déclaratives de conformité : chartes, engagements, formations ou dispositifs de gouvernance sans traduction opérationnelle consolidée. Il ne s’agit pas nécessairement de fraude, mais d’une adaptation défensive à un environnement instable, hétérogène et à maille fine.
Les effets recensés dans le cas d’Airbus ne relèvent pas d’anomalies isolées, mais d’une grammaire systémique observable dans tout environnement soumis à des régulations croisées, hétérogènes et potentiellement conflictuelles.
La section suivante cartographie des effets juridiquement évaluables dans des contextes analogues de régulation distribuée, afin d’éprouver leur soutenabilité normative et d’en tester la recevabilité dans d’autres environnements.
Cette mise en perspective éclaire la dynamique globale : saturation normative, contraintes probatoires asynchrones, déséquilibres procéduraux, et expansion d’une régulation distribuée fondée sur la preuve.
5. Effets systémiques secondaires (observables ou juridiquement plausibles)
5.a Superposition de cadres sans articulation structurée
- Constat : coexistence de régimes distincts de conformité sans mécanisme d’articulation explicite (par exemple RGPD, Cloud Act, ITAR).
- Effet : surcharge procédurale, absence de hiérarchisation en cas de conflit normatif, allongement des circuits de décision.
- Sources : audits internes, analyses CNIL (transferts internationaux), doctrine en matière de compliance transnationale.
5.b Éclatement de la chaîne de preuve
- Constat : les pièces recevables dans un référentiel (Sapin II, RGPD, ITAR) peuvent être irrecevables dans un autre.
- Effet : affaiblissement de la force probante, difficultés de réutilisation entre audits, fragilisation en contentieux.
- Sources : contentieux transatlantiques, retours de juristes en entreprise, analyses sur les régulations multi-niveaux.
5.c Tension entre innovation et exigences réglementaires
- Constat : certains secteurs (IA, cybersécurité, capteurs) sont soumis à des obligations anticipatoires (AI Act, dual use) encore instables.
- Effet : ralentissement de projets, externalisation des phases expérimentales hors UE, perte d’avantage concurrentiel sur des segments critiques.
- Sources : rapports industriels, études parlementaires sur l’effet inhibiteur des normes émergentes.
5.d Effets inverses induits par la conformité
- Constat : des dispositifs tels que le reporting CSRD ou les obligations FCPA peuvent générer des risques non anticipés (par exemple fragilité de la chaîne fournisseur, exposition concurrentielle, attaques réputationnelles).
- Effet : des mécanismes censés sécuriser l’organisation deviennent vecteurs de vulnérabilités juridiques, économiques ou réputationnelles.
- Sources : jurisprudence en matière d’alerte éthique, sanctions extraterritoriales, analyses doctrinales des effets inversés du reporting.
5.e Asymétrie procédurale dans la coopération judiciaire
- Constat : certains régimes (Cloud Act, FCPA) permettent un accès privilégié aux données ou à l’initiation d’enquêtes par des autorités non-européennes, sans équivalent côté entreprises de l’UE.
- Effet : déséquilibre structurel dans les procédures transnationales, atteinte aux capacités de défense et à la souveraineté procédurale.
- Sources : litiges transfrontaliers, travaux sur la portée extraterritoriale asymétrique des juridictions.
5.f Externalisation diffuse de la décision juridique
- Constat : le traitement des obligations repose de plus en plus sur des dispositifs d’auto-justification (compliance-by-design, audits techniques) en amont de tout processus juridictionnel.
- Effet : dilution des responsabilités, multiplication des seuils de recevabilité internes, transfert implicite du pouvoir d’évaluation vers des tiers (auditeurs, prestataires).
- Sources : analyses doctrinales sur la régulation algorithmique, études sectorielles sur la distribution des fonctions de contrôle.
⸻
Clause de neutralité : Cette cartographie repose sur une analyse d’effets juridiquement plausibles. Elle ne constitue ni un avis juridique ni une recommandation normative.
6. Conditions de lisibilité des effets dans un système normatif fragmenté
Dans des environnements comme celui d’Airbus, marqués par la superposition de régimes juridiques autonomes (RGPD, FCPA, Cloud Act, règlement IA, Sapin II, ITAR…), l’évaluation des résultats induits par la structure de conformité suppose une lecture articulée de trois dimensions majeures : le cadre normatif en interaction instable, les logiques d’action divergentes, et le degré d’imprévisibilité des conséquences observées.
6.a Superposition des normes sans articulation stabilisée
La coexistence de cadres juridiques issus de sources hétérogènes (réglementation européenne, droit extraterritorial américain, régimes sectoriels de type dual use ou ITAR) engendre des conséquences juridiquement valides dans un contexte, mais potentiellement illisibles, inacceptables ou contradictoires dans un autre.
Exemples :
- une divulgation imposée par le FCPA peut contrevenir à des obligations de confidentialité contractuelle ou de secret des affaires ;
- un transfert de données licite selon une autorité de contrôle nationale peut être jugé non conforme dans un cadre extraterritorial.
Cette instabilité rend difficile l’établissement de référentiels d’audit transversaux ou l’élaboration de politiques internes unifiées.
6.b Divergence structurelle des logiques d’action
Les dispositifs de conformité sont traversés par des injonctions partiellement incompatibles :
- logique de prévention (contrôle en amont, sécurisation, minimisation des risques) ;
- logique de transparence (reporting, traçabilité, signalement) ;
- logique de rétention ou d’opacité stratégique (protection de l’innovation, clauses classifiées, souveraineté technique) ;
- logique de partage contraint (coopération judiciaire, interopérabilité réglementaire, audits externes).
Le système ne permet pas toujours d’arbitrer formellement entre ces logiques, générant des zones d’indécidabilité ou des choix implicites non documentés, en particulier dans la gestion des preuves, la désignation des responsabilités ou la communication inter-fonctionnelle (juridique, SSI, direction générale…).
6.c Instabilité des conséquences
Même en présence d’une conformité formelle, les retombées des choix opérés restent difficilement prévisibles :
- un reporting effectué dans les règles peut entraîner une requalification contentieuse dans un espace juridique distinct ;
- une mesure de protection technique peut être interprétée comme une obstruction ou une rétention d’information ;
- une mise en conformité sectorielle peut produire un désalignement avec des standards internationaux attendus par des clients, partenaires ou autorités de contrôle étrangères.
Ce degré d’incertitude rend partielle toute stratégie de défense anticipée, et fragilise la soutenabilité juridique des arbitrages réalisés par les fonctions concernées.
6.d Représentation schématique possible
Une visualisation structurée permettrait de cartographier les nœuds de tension internes à la structure de conformité d’un acteur comme Airbus, en mettant en relation :
- les régimes juridiques en interaction (normes européennes, américaines, sectorielles) ;
- les chaînes décisionnelles impliquées (conformité, direction juridique, DPO, RSSI, filiales) ;
- les zones d’impact instables (transferts, audits, preuves, sanctions, reporting, etc.).
Un tel schéma rendrait visibles les vulnérabilités systémiques non imputables à un manquement, mais à l’instabilité des architectures normatives elles-mêmes.
6.e Conditions de recevabilité dans les régimes impliqués
L’un des enjeux majeurs tient à la question suivante : quels résultats sont considérés comme acceptables ou recevables par une instance d’évaluation explicite ?
Il ne s’agit pas ici de déterminer si un comportement est conforme ou non, mais de savoir si les manifestations observables (transfert, publication, silence, signalement, chiffrement, etc.) seront lisibles, compréhensibles et interprétables dans un ordre juridique donné.
Exemples :
- un audit RGPD peut être jugé insuffisant dans un cadre extraterritorial de type Cloud Act ;
- une mesure de restriction d’accès légitime au regard de la sécurité peut être requalifiée en entrave dans un contentieux pénal ou concurrentiel ;
- une absence de signalement en matière de vigilance peut devenir litigieuse dans un contexte de responsabilité partagée.
Cette incertitude de recevabilité impose de déplacer l’analyse vers les conditions de lisibilité et d’évaluation des résultats, plutôt que de s’en tenir aux seules catégories classiques d’obligations de moyens ou de résultat.
Car si l’obligation de résultat repose sur un effet attendu et identifiable, la lecture fonctionnelle élargit le champ : elle permet d’appréhender des manifestations multiples, non hiérarchisées, parfois inverses, produites dans des environnements dépourvus d’une architecture stabilisée d’imputabilité, c’est-à-dire d’un cadre clair permettant d’attribuer les effets à un acteur, une règle ou un régime.
7. Outiller la compliance dans des contextes juridiquement non harmonisés
L’analyse montre que les tensions observables dans les dispositifs de conformité ne procèdent ni de déficiences techniques, ni d’erreurs localisées, mais relèvent d’effets systémiques induits par l’instabilité du cadre normatif global. Les zones d’indécidabilité, impossibilité d’arbitrer entre injonctions contradictoires, désalignements entre obligations sectorielles et exigences transnationales, saturation des chaînes de contrôle, apparaissent comme des manifestations ordinaires d’un environnement privé de principe hiérarchique unificateur.
Ce constat déplace plusieurs fondements du droit classique :
- la non-contradiction, rendue inopérante par la coexistence d’exigences incompatibles (transparence vs rétention, transfert vs localisation) ;
- la hiérarchie des normes, inapplicable hors d’un espace juridique commun ;
- l’autonomie de la volonté, refragée par la prolifération d’obligations impératives, souvent extraterritoriales.
Dans ce contexte, les mécanismes de compliance produisent des effets inversés : génération non intentionnelle de preuves auto-incriminantes, valorisation contentieuse de la surcharge procédurale, exposition réputationnelle par obligation de signalement. Ces résultats ne traduisent pas une dérive, mais un déplacement fonctionnel dans un environnement à régulation distribuée.
La lecture fonctionnelle permet de structurer l’évaluation en articulant trois éléments : effets produits, régimes mobilisés, logiques d’action en présence. Elle outille les décisions dans les situations où l’accumulation de prescriptions interdit toute hiérarchisation stable. La conformité cesse d’être l’application d’un texte, pour devenir un effet stabilisable dans un système sans ordre consolidé.
7.a Apport stratégique
La lecture fonctionnelle fournit une grille de décision dans les environnements saturés de contraintes hétérogènes. Elle permet d’arbitrer sans attendre de résolution normative, en identifiant tensions, indécidabilités et points d’ancrage stabilisables. Elle aligne les impératifs opérationnels, les exigences légales et les dynamiques réelles d’effet, sans réduction des tensions.
7.b Apport juridique
Elle autorise une évaluation rigoureuse des effets juridiquement recevables. Elle anticipe les seuils d’acceptabilité, objectivise les conflits normatifs et fonde des choix documentés même en l’absence d’harmonisation. Elle soutient la viabilité juridique non par empilement normatif, mais par articulation défendable des effets au sein de leur environnement contraint.
7.c Apport conceptuel
La lecture fonctionnelle fournit une architecture de pensée apte à réguler sans hiérarchie imposée. Elle modélise les effets comme objets d’évaluation, non comme simples conséquences d’un corpus. Elle préserve la légitimité des dispositifs dans les configurations où les repères classiques, hiérarchie, volonté, unité d’espace, se disloquent.
7.d Effet de levier
La lecture fonctionnelle devient ainsi un levier stratégique :
- pour rendre visibles les arbitrages sous-jacents, y compris dans les configurations extraterritoriales ou non alignées ;
- pour fonder une justification recevable là où la conformité textuelle devient inapplicable ou contradictoire, en stabilisant l’analyse autour des effets eux-mêmes ;
- pour maintenir la lisibilité de la compliance lorsque les repères traditionnels se dissolvent, en structurant l’évaluation des dynamiques en présence.
Elle ne reconstruit pas un ordre perdu, mais permet de structurer l’analyse en son absence. En mettant rigoureusement en correspondance effets, régimes et contraintes d’acceptabilité, elle rend la conformité opérable, défendable et stratégique dans les systèmes où l’instabilité constitue désormais la norme.
Voir BibTeX (@article)
@article{metalexis2025airbustransnationale,
title = {Airbus \&\#8211; Compliance transnationale et chevauchements normatifs : analyse fonctionnelle des effets d’ind{{\'e}}cidabilit{{\'e}} juridique},
author = {{MetaLexis}},
year = {2025},
month = aug,
journal = {Analyses Fonctionnelles - Compliance},
url = {https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/compliance/airbus-transnationale/},
note = {Disponible sur metalexis.org}
}Voir BibLaTeX (@online)
@online{metalexis2025airbustransnationale,
author = {{MetaLexis}},
title = {Airbus \&\#8211; Compliance transnationale et chevauchements normatifs : analyse fonctionnelle des effets d’ind{{\'e}}cidabilit{{\'e}} juridique},
date = {2025-08-26},
url = {https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/compliance/airbus-transnationale/},
urldate = {2025-09-28},
langid = {french},
keywords = {Compliance, Airbus, architecture juridique, compliance, conformit{{\'e}}, ind{{\'e}}cidabilit{{\'e}}, normes, obligations extraterritoriales, r{{\'e}}gulation transnationale, responsabilit{{\'e}}s juridiques},
note = {Disponible sur metalexis.org}
}Voir RIS
TY - ELEC TI - Airbus – Compliance transnationale et chevauchements normatifs : analyse fonctionnelle des effets d’indécidabilité juridique AU - MetaLexis PY - 2025 DA - 2025-08-26 UR - https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/compliance/airbus-transnationale/ KW - Compliance KW - Airbus KW - architecture juridique KW - compliance KW - conformité KW - indécidabilité KW - normes KW - obligations extraterritoriales KW - régulation transnationale KW - responsabilités juridiques LA - fr PB - MetaLexis ER -