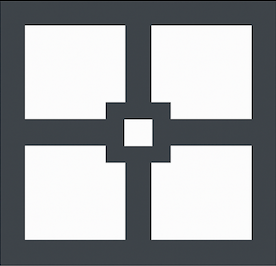L’article propose une lecture en amont du litige pour qualifier le « contentieux systémique », en s’appuyant sur des critères analytiques stabilisables plutôt que sur des usages discursifs.
Un contentieux devient systémique lorsqu’il procède d’effets récurrents issus d’un système identifiable, selon une combinatoire démontrable d’éléments internes (règles, temporalités, chaînes décisionnelles, dispositifs techniques, filtres cognitifs).
Une typologie des glissements et une méthode de lecture des effets avant contentieux permettent de distinguer l’effet structurel de l’effet ponctuel, de relier des dommages dispersés et d’identifier les points de bascule.
Cette approche renforce la preuve, la reconnaissance et la cohérence des réparations, alimente des stratégies de régulation et de vigilance, et prépare un second volet consacré à la qualification juridictionnelle du « contentieux systémique ».
- Le contentieux systémique se définit opérationnellement comme des effets récurrents issus d’une combinatoire identifiable au sein d’un système, établis par une lecture structurelle.
- Pour distinguer l’effet narré de l’effet combiné, il convient de surveiller les glissements temporels et causaux, la naturalisation des effets et l’effacement des dispositifs contributifs.
- Une méthode d’amont consiste à repérer des régularités, à relier des dommages dispersés, à identifier des points de bascule et à documenter des effets émergents en amont du procès.
- L’enjeu pratique est d’outiller gouvernance, conformité et technique pour une auto-lecture qui aligne régulation et vigilance, réduit les asymétries et ouvre des marges de transformation avant la cristallisation contentieuse.
Introduction
Dans le paysage juridictionnel contemporain, l’expression “contentieux systémique” occupe une place croissante. Elle apparaît dans des discours institutionnels, des décisions de justice, des cadres d’action publique ou privée. Pourtant, les conditions permettant de qualifier un contentieux comme systémique restent encore peu explicitées ou stabilisées, notamment sur le plan analytique.
Or, un contentieux ne devient systémique ni par déclaration, ni par accumulation, ni par consensus. Il le devient parce qu’il prend sa source dans des effets récurrents, produits par un système identifiable, selon une combinatoire démontrable. Ces effets ne se réduisent ni à l’intention des acteurs, ni à l’ampleur du préjudice, ni à la pluralité des victimes : ils relèvent d’un mode de production structuré du dommage.
Ce premier article propose de déplacer le regard en amont du contentieux. Il ne s’agit pas ici de discuter des juges, des réformes de procédure, des catégories doctrinales mais d’outiller une lecture des effets systémiques produits avant le litige, dans les systèmes eux-mêmes, publics ou privés, locaux ou transnationaux.
C’est dans l’amont que se jouent souvent les conditions de soutenabilité des actions futures : capacité à prouver, à faire reconnaître, à formuler des réparations cohérentes. Mais c’est aussi dans cet amont que peuvent se construire des stratégies de régulation, de vigilance, ou de transformation non contentieuse.
1. Pourquoi parler d’« effets systémiques » nécessite une démonstration
L’expression « effets systémiques » tend à s’imposer comme catégorie discursive avant d’être analysée comme structure. Elle mobilise une intuition de gravité ou d’ampleur, sans toujours s’ancrer dans une démonstration rigoureuse. Or, un effet ne devient systémique ni par la force du récit, ni par sa récurrence seule, ni même par l’accumulation de cas. Il le devient lorsqu’il résulte d’une combinatoire identifiable entre éléments internes au système : agencements, règles, temporalités, chaînes de décision, filtres cognitifs, dispositifs techniques.
Parler d’effet systémique suppose donc plus qu’une catégorisation : cela suppose une lisibilité formelle de la structure de production de cet effet. Sans cette démonstration, le terme reste performatif, assignant une portée globale à des dommages dont les causes réelles demeurent floues. C’est dans ce flou que les effets les plus graves deviennent les moins imputables.
2. Typologie des glissements : effet narré vs effet combiné
Entre l’effet tel qu’il est narré (dans un rapport, une plainte, un récit institutionnel) et l’effet tel qu’il est combiné (par l’interaction d’éléments systémiques), plusieurs glissements peuvent s’opérer, volontairement ou non. Ces glissements fragilisent la compréhension de ce qui s’est réellement produit et rendent difficile toute action régulatrice cohérente.
Parmi ces glissements :
- La translation temporelle : le dommage est attribué à un événement ponctuel, alors qu’il résulte d’une construction étalée.
- La dissociation causale : un acteur est désigné comme responsable, sans que la structure systémique qui a permis le dommage ne soit examinée.
- La naturalisation des effets : certains effets sont présentés comme inévitables ou normaux, alors qu’ils pourraient être prévenus par une régulation interne.
- L’effacement des dispositifs contributifs : certaines architectures décisionnelles ou techniques ne sont pas identifiées comme causes contributives du dommage.
Outiller cette typologie des glissements permet de différencier les récits d’effet des effets produits structurellement. Ce travail est essentiel pour stabiliser l’usage du terme « systémique » et éviter qu’il ne masque ce qu’il prétend éclairer.
3. Ce que permet une lecture des effets avant litige
Avant que les effets ne deviennent matière contentieuse, ils peuvent déjà être lisibles à condition de disposer d’une méthode de lecture. Cette méthode ne dépend ni d’un accès judiciaire, ni d’un pouvoir d’enquête : elle repose sur la capacité à identifier des régularités dans les effets, des récurrences dans les formes de dommage, des convergences entre situations en apparence isolées.
Une lecture des effets permet de :
- distinguer l’effet ponctuel de l’effet structurel,
- relier des dommages dispersés à une même logique interne,
- repérer les points de bascule où un effet maîtrisable devient systémique,
- documenter les effets émergents avant leur reconnaissance formelle.
Ce type de lecture ne remplace pas l’action contentieuse. Il la précède, l’éclaire, ou parfois l’évite. Il permet aux acteurs situés en amont du litige de ne pas attendre le procès pour reconnaître ce que produit leur propre système.
4. Comment un système produit, étale, invisibilise ou concentre les dommages
Certains systèmes ne produisent pas de dommage massif en un instant. Ils étalent les effets, les diffusent, les diluent, ou les concentrent sans en produire la lisibilité immédiate. L’effet devient alors plus difficile à circonscrire, à prouver, à attribuer.
Ce type de configuration est fréquent dans les systèmes :
- où les responsabilités sont segmentées ou mutualisées,
- où les décisions sont automatisées ou distribuées,
- où les signaux faibles ne sont ni remontés ni interprétés comme tels.
Dans ces cas, le dommage n’est pas un accident : il est le produit d’une architecture, parfois sans intention ni manquement, mais avec une puissance combinatoire suffisante pour produire des effets répétés, déstabilisants, voire irréversibles.
L’absence de dispositif interne de vigilance – ou sa neutralisation par des logiques de performance, de secret ou de déni – empêche toute mise en visibilité de ces effets. Cette forme de défaillance structurelle peut être lue comme une non-compliance silencieuse : non pas parce qu’elle viole une règle, mais parce qu’elle laisse se produire des effets régulatoires sans capacité d’auto-lecture.
5. Pourquoi les acteurs (publics/privés) doivent pouvoir outiller cette lecture avant que le juge intervienne
Lorsqu’un système produit des effets qui pourraient un jour faire l’objet d’un contentieux systémique, il importe que ses acteurs puissent en anticiper la combinatoire, non pas pour en éviter la reconnaissance, mais pour en réguler la formation. Cette capacité d’auto-lecture, partagée entre gouvernance, conformité, direction technique et pilotage opérationnel, devient un levier stratégique majeur.
Outiller cette lecture, c’est :
- réduire l’asymétrie entre ce que le système produit et ce qu’il reconnaît ;
- renforcer la cohérence entre stratégie, régulation et vigilance ;
- éviter l’instrumentalisation des effets dans une logique défensive ou opportuniste ;
- ouvrir des marges de transformation avant la cristallisation contentieuse.
Cette posture n’est pas réservée aux juristes. Elle concerne aussi les ingénieurs, les responsables opérationnels, les décideurs politiques ou économiques. Tous ceux qui, à un moment, participent à la fabrique d’un système – ou à sa stabilisation – sont concernés par cette capacité à lire ses effets avant qu’ils ne deviennent opposables.
Conclusion
Lire ce que produit un système, c’est rendre visibles les effets qu’il génère, structurellement, avant qu’ils ne soient traduits dans les catégories du litige. C’est permettre à des acteurs – publics, privés, institutionnels ou opérationnels – de repérer les régularités, les tensions, les points d’aveuglement internes qui rendent possibles des dommages récurrents.
Cette lecture structurelle ne vise pas à anticiper une décision judiciaire, mais à renforcer les capacités d’analyse et de régulation dans l’amont du contentieux. Elle outille une vigilance fonctionnelle, avant toute qualification formelle.
À ce titre, elle constitue une base de travail mobilisable dans les champs de la régulation, de la compliance, de la gouvernance ou de la responsabilité collective.
Reste à interroger ce que deviennent ces effets une fois entrés dans l’espace juridictionnel, et comment la qualification de « contentieux systémique » se construit – ou se fragilise – dans les arènes judiciaires.
Cette question fait l’objet d’un second article : Ce que devient un contentieux – Enjeux et limites du contentieux systémique
Voir BibTeX (@article)
@article{metalexis2025contentieuxsystemique1cequeproduitunsysteme,
title = {Le contentieux syst{{\'e}}mique \&\#8211; part 1 Ce que produit un syst{\`e}me : Lire l’amont du contentieux syst{{\'e}}mique},
author = {{MetaLexis}},
year = {2025},
month = oct,
journal = {Analyses Fonctionnelles - Compliance},
url = {https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/contentieux-systemique-1-ce-que-produit-un-systeme/},
note = {Disponible sur metalexis.org}
}Voir BibLaTeX (@online)
@online{metalexis2025contentieuxsystemique1cequeproduitunsysteme,
author = {{MetaLexis}},
title = {Le contentieux syst{{\'e}}mique \&\#8211; part 1 Ce que produit un syst{\`e}me : Lire l’amont du contentieux syst{{\'e}}mique},
date = {2025-10-07},
url = {https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/contentieux-systemique-1-ce-que-produit-un-systeme/},
urldate = {2026-01-20},
langid = {french},
keywords = {Compliance, compliance, contentieux syst{{\'e}}mique, r{{\'e}}gulation},
note = {Disponible sur metalexis.org}
}Voir RIS
TY - ELEC TI - Le contentieux systémique – part 1 Ce que produit un système : Lire l’amont du contentieux systémique AU - MetaLexis PY - 2025 DA - 2025-10-07 UR - https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/contentieux-systemique-1-ce-que-produit-un-systeme/ KW - Compliance KW - compliance KW - contentieux systémique KW - régulation LA - fr PB - MetaLexis ER -