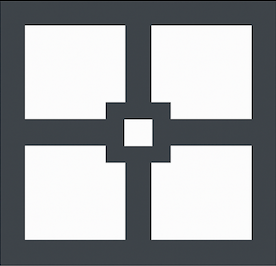Le terme « contentieux systémique » se diffuse dans des arènes variées et appelle des critères opératoires stabilisés pour fonder une qualification solide.
Employée comme acte de langage, la qualification produit un effet de légitimation, déplace la charge de la preuve et met sous tension l’égalité des armes.
Lorsque la qualification devance la démonstration, le procès s’expose à une fragilité épistémique et le débat glisse des faits vers l’autorité du récit.
Une grille analytique neutre et partageable renforce la soutenabilité du procès en réduisant les asymétries interprétatives, en objectivant les causalités systémiques et en dissociant l’évaluation des effets de leur qualification juridique immédiate.
- Le terme contentieux systémique se diffuse sans définition stabilisée, d’où la nécessité de critères opératoires communs pour fonder la qualification.
- La qualification peut agir performativement, déplacer la charge de la preuve et créer des asymétries qui mettent sous tension l’égalité des armes.
- Quand la qualification devance la démonstration, le procès devient épistémiquement fragile et le débat glisse des faits vers l’autorité du récit.
- Une grille analytique neutre et partageable, indépendante des énonciateurs, permet d’objectiver les causalités systémiques, de réduire les asymétries et de dissocier l’évaluation des effets de la qualification juridique.
Introduction
L’article précédent proposait une lecture rigoureuse des effets systémiques en amont du contentieux, avant toute qualification judiciaire. Il montrait comment un système peut produire, étaler ou invisibiliser des dommages sans que ceux-ci soient immédiatement reconnus comme tels, ni imputés à un acteur désigné.
Cette désignation a fait l’objet de travaux doctrinaux et institutionnels, qui en soulignent l’intérêt. Mais les critères permettant de qualifier rigoureusement un contentieux comme systémique demeurent à ce jour partiels, variables selon les contextes, et rarement formalisés dans des grilles opératoires.
Mais que deviennent ces effets une fois traduits dans l’arène juridictionnelle ? Que produit, à son tour, la qualification de contentieux systémique ? Quelles sont ses vertus, ses risques, ses limites ?
Ce second article examine les conditions dans lesquelles un contentieux peut être désigné comme systémique par le juge, les parties ou les institutions, et interroge la solidité de cette désignation. Il ne s’agit pas de discuter la légitimité du concept, mais d’outiller l’analyse de ses usages – notamment lorsque la qualification précède la démonstration.
L’objectif n’est pas de contester la légitimité de cette catégorie émergente, mais d’interroger les conditions de sa recevabilité argumentative, indépendamment du statut de l’acteur qui l’emploie.
1. Analyse critique des usages du terme « contentieux systémique »
L’expression contentieux systémique circule aujourd’hui dans une pluralité de contextes : jurisprudence, doctrine, plans de réformes, plaidoyers collectifs. Mais cette diffusion rapide s’accompagne d’une absence de définition stabilisée, et parfois d’un usage extensif qui dilue sa portée structurante.
Certains usages s’appuient sur le nombre de victimes, d’autres sur la gravité du préjudice, d’autres encore sur l’implication de structures publiques. Or, ces critères – bien qu’indicatifs – ne suffisent pas à établir une causalité systémique.
À défaut de référentiel démonstratif commun, la qualification devient fragile :
- Flottement terminologique entre systémique, structurel, massif, collectif…
- Risque de captation stratégique : instrumentalisation du terme à des fins rhétoriques ou politiques.
- Inégalités d’accès à la capacité de nommer un contentieux comme systémique (ONG vs individu, État vs salarié…).
2. Risques de performativité : qualifier sans démontrer
Dans certains cas, le simple fait d’énoncer qu’un contentieux est systémique produit un effet de légitimation immédiate. Le terme agit comme un acte performatif, où l’énonciateur (juge, institution, acteur collectif) produit de la validité par sa seule autorité.
Ce phénomène pose plusieurs problèmes :
- Il déplace la charge de la preuve : ce n’est plus la structure du dommage qui est démontrée, mais la crédibilité de celui qui la nomme.
- Il fragilise l’égalité des armes : si une partie peut faire reconnaître la systémicité sans preuve formelle, l’autre se retrouve en position défensive sans base claire d’analyse.
- Il court-circuite la construction contradictoire du procès : le débat n’a plus lieu sur les faits, mais sur l’autorité du récit.
3. Danger d’une fragilité épistémique du procès (récit vs preuve)
Lorsque le procès repose sur une qualification systémique non démontrée, il s’expose à une forme de fragilité épistémique : le jugement se construit sur une lecture du réel partiellement vérifiée, voire indémontrable.
Ce danger n’est pas marginal :
- Il touche les contentieux à fort enjeu symbolique (discriminations, inégalités structurelles, violences institutionnelles) ;
- Il crée une zone grise entre argumentation juridique et narrativité militante ;
- Il rend plus difficile le travail du juge, qui doit trancher entre des récits de structure sans fondation commune.
Dans ce contexte, le procès perd sa fonction stabilisatrice, et peut au contraire devenir le prolongement incertain de conflits d’interprétation non régulés.
4. L’exigence d’une grille soutenable, indépendante des énonciateurs
Lorsqu’un contentieux est qualifié de systémique, la juridiction se confronte à des effets dont la causalité n’est ni localisable ni individualisable dans le schéma classique de la responsabilité. Cette dispersion des causes découle souvent d’une non-compliance structurelle non traitée en amont – que le juge est sommé d’interpréter comme système.
Mais en l’absence de grille démonstrative soutenable, indépendante des parties, le risque est double :
- Soit le juge refuse la qualification, au motif qu’elle n’est pas prouvée, au détriment de victimes réelles ;
- Soit il l’accepte sur la base d’un récit convaincant mais fragilement vérifiable.
L’un comme l’autre affaiblissent l’autorité épistémique du jugement. Ce n’est pas la fonction juridictionnelle qui est ici en cause, mais l’absence d’outillage formel partagé pour lire les effets systémiques.
Une grille neutre, structurée, opérable par différentes parties – sans dépendre d’un énonciateur unique – devient alors une condition de soutenabilité du procès.
5. Ce que permet une structure analytique neutre et partageable
Une telle structure permettrait :
- de réduire l’asymétrie interprétative entre les parties,
- de rendre visibles les effets sans dépendre du registre émotionnel,
- de clarifier ce qui relève d’un système, d’un manquement, d’une causalité indirecte,
- de séparer l’évaluation des effets de leur qualification juridique immédiate.
Elle ne se substitue pas à la justice : elle en renforce la rigueur et la recevabilité dans des contentieux à forte charge systémique. Elle permet aussi d’encadrer les effets produits par l’office du juge, notamment lorsqu’il est amené à se saisir d’office ou à réinterpréter des normes à portée générale.
Conclusion
Qualifier un contentieux de systémique n’est pas anodin. C’est un acte à forte portée symbolique, stratégique, mais aussi méthodologique. Sans grille rigoureuse, le terme risque d’agir comme un révélateur sans preuve, un amplificateur sans base.
Pour que le contentieux systémique devienne une catégorie juridique stable, il faut pouvoir le démontrer. Cela suppose une lecture structurée des effets – en amont, mais aussi dans l’arène judiciaire – fondée sur des régularités objectivables, des combinaisons explicites, une architecture causale vérifiable.
C’est à cette condition que la justice pourra reconnaître – sans produire elle-même – ce que le système génère.
Cette exigence ne remplace ni l’analyse juridique ni l’office du juge : elle les précède comme condition de lisibilité des effets que le système a pu produire avant l’intervention juridictionnelle.
Voir BibTeX (@article)
@article{metalexis2025contentieuxsystemique2enjeuxetlimites,
title = {Le contentieux syst{{\'e}}mique - part 2 Ce que devient un contentieux : Enjeux et limites du contentieux syst{{\'e}}mique},
author = {{MetaLexis}},
year = {2025},
month = oct,
journal = {Analyses Fonctionnelles - Compliance},
url = {https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/contentieux-systemique-2-enjeux-et-limites/},
note = {Disponible sur metalexis.org}
}Voir BibLaTeX (@online)
@online{metalexis2025contentieuxsystemique2enjeuxetlimites,
author = {{MetaLexis}},
title = {Le contentieux syst{{\'e}}mique - part 2 Ce que devient un contentieux : Enjeux et limites du contentieux syst{{\'e}}mique},
date = {2025-10-07},
url = {https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/contentieux-systemique-2-enjeux-et-limites/},
urldate = {2026-01-20},
langid = {french},
keywords = {Compliance, compliance, contentieux syst{{\'e}}mique, r{{\'e}}gulation},
note = {Disponible sur metalexis.org}
}Voir RIS
TY - ELEC TI - Le contentieux systémique - part 2 Ce que devient un contentieux : Enjeux et limites du contentieux systémique AU - MetaLexis PY - 2025 DA - 2025-10-07 UR - https://metalexis.org/analyses-fonctionnelles/contentieux-systemique-2-enjeux-et-limites/ KW - Compliance KW - compliance KW - contentieux systémique KW - régulation LA - fr PB - MetaLexis ER -